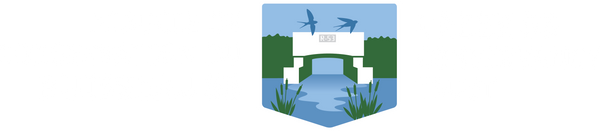Un retour dans le passé ...
-
La géologie du bassin versant du ruisseau 53
Le bassin versant du ruisseau 53 se trouve dans une écorégion connue comme les basses-terres du Saint-Laurent. Son étendue correspond aux eaux et aux terres qui entourent la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent. Elle est densément peuplée car elle compte quelques-unes des plus grandes villes canadiennes, dont Montréal, Ottawa et Québec. Une grande partie de la région est consacrée à l’agriculture, qu’il s’agisse de terres cultivées ou d’exploitations laitières. Les forêts y sont majoritairement mixtes (feuillus et résineux) et, outre les plus grands cours d’eau qui s’écoulent vers l’océan, les milieux humides y sont abondants.
Les écosystèmes que nous voyons aujourd’hui dans les basses-terres du Saint-Laurent résultent tous du passé géologique de la région. Même si la géologie concerne souvent les longues périodes – l’histoire ancienne, avec le mouvement des continents – l’histoire plus récente, notamment la glaciation, a fortement défini la région. Le bassin versant du ruisseau 53 et l’ensemble de la région ont manifestement été façonnés sur une échelle de temps de dizaines de milliers d’années.
Bien sûr, des reliefs plus anciens y sont toujours présents, et très visibles ! Par exemple le mont Rigaud, formé d’anciennes roches ignées, est estimé à 720 millions d’années – il est certainement l’élément visible du paysage le plus ancien de la région. Des éminences comme le mont Oka, le mont Royal, et toutes les autres Montérégiennes, sont des jeunettes en comparaison : ces intrusions ignées se sont formées il y a 100 à 140 millions d’années. Mais entre ces collines, là où vivent la plupart des gens, la majeure partie de l’agriculture régionale et d’autres éléments du paysage sont très jeunes, du moins à l’échelle des temps géologiques.
-

-
Le dernier maximum glaciaire remonte à environ 18 000 ans, et durant cette période les basses-terres du Saint-Laurent furent couvertes d’une couche de glace d’un kilomètre ou plus d’épaisseur. Lorsque les glaciers reculèrent, ils laissèrent d’immenses marques au sol et plusieurs sortes de dépôts sur divers types de crêtes et de collines. Ces dépôts sont généralement bien drainés et donnent souvent des sols sableux ou limoneux-sableux. De nos jours, sur ces crêtes on voit souvent des bouquets ou des rangées de pins blancs d’origine naturelle : cette espèce de conifère préfère que ses racines soient bien drainées.
-

-
Le « till » glaciaire, mélange hétérogène de dépôts éparpillés en divers endroits de notre paysage, comprend toutes sortes de roches aux formes et aux dimensions très diverses. Pour certains agriculteurs de la région cela représenta un casse-tête et un travail éreintant car, pour préparer la terre à la culture, il leur fallut les enlever. Dans bien des cas ces roches furent empilées pour faire des clôtures ou des rangs nets entre les champs, ou pour délimiter une propriété.
-

-
Il y a 18 000 ans, le poids des glaciers était évidemment considérable et ils contenaient des quantités d’eau tout simplement inimaginables. Nous en ressentons encore les effets – dans la région de Montréal, les tremblements de terre actuels sont des « rebondissements » de notre continent résultant du poids du glacier qui l’écrasa jadis –
ces « rebonds isostatiques », comme on les appelle, secouent encore notre monde. Nos tremblements de terre sont un effet persistant de la dernière grande glaciation.Tandis que la planète se réchauffait et que les glaciers reculaient, non seulement l’eau de fonte qui s’écoulait forma de gigantesques étendues d’eau, mais l’affaissement des terres sous son poids permit l’afflux d’eaux océaniques qui se mêlèrent aux eaux douces. Dans l’est de l’Ontario et l’ouest du Québec, cela donna la mer de Champlain. Cette vaste étendue d’eau explique les sols de la région, les basses-terres du Saint-Laurent sont en majeure partie des sédiments d’argile marine formés par cette ancienne mer. Ces sols se drainent mal et sont rapidement saturés, et cette capacité de retenir l’eau ainsi que leur planéité (« basses-terres ») donnent de nos jours les terres agricoles de choix que l’on trouve dans toute la région montréalaise – aussi bien sur l’île de Montréal (p. ex. les terres agricoles du campus Macdonald), que près de Saint-Clet, ou dans les champs de tournesol, de soya ou de maïs que l’on voit en roulant de Montréal à la frontière de l’Ontario.
Les basses-terres ne se caractérisent par toutes par des sols argileux saturés. Outre les crêtes et les plus petites collines mentionnées plus haut, la mer de Champlain fut aussi bordée de plages. Ces plages étaient bien sûr sableuses, et comme au fil des millénaires la mer s’éleva (puis redescendit) elles se déposèrent à différents niveaux. À Montréal, le Plateau-Mont-Royal fut autrefois une plage, et lorsqu’on regarde vers le sud à partir du Mont-Royal on peut imaginer les anciennes plages telles des marches descendant jusqu’à l’actuel Saint-Laurent. Le sol bien drainé des anciennes plages de sable est parfait pour des vergers ou d’autres types particuliers d’agriculture, d’où les pommeraies sur les pentes des collines montérégiennes (p. ex. au mont Oka et au mont Saint-Hilaire) – alors qu’on n’en voit généralement pas dans les plaines argileuses. Comme les pins, ces espèces n’aiment pas avoir des racines détrempées.
La délimitation entre les anciens dépôts argileux de la mer de Champlain et les dépôts sableux (des plages ou des dépôts glaciaires) n’est jamais parfaite ni facile à faire. C’est pour cela que dans des villes comme Hudson le sol est dans certains endroits à dominante argileuse, et dans d’autres à dominante sableuse. Dans les premiers, les champs d’épuration sont facilement saturés, contrairement aux seconds ! Certaines personnes peuvent faire pousser des pommiers ou un petit verger, dont les limites seront finalement déterminées par les types de sols sous-jacents.
Dans les propriétés protégées par la Fiducie de conservation du ruisseau 53 ces phénomènes géologiques sont nettement visibles – l’« escarpement d’Hudson » est une crête laissée lors du recul du glacier – rochers, sols sableux le long du talus, et des pins sur la crête dans certains endroits. Il y a aussi des amas rocheux en d’autres endroits de cette crête, en partie à sa base, et l’on en trouve également dans des secteurs boisés. Dans les secteurs de faible altitude des propriétés protégées les étendues d’eau se trouvent dans des zones plus argileuses, tandis que les terres agricoles plus proches de la rivière des Outaouais ne sont rien d’autre que l’ancien fonds marin.
-

-
Au fil du temps le glacier continua à reculer, et l’on peut imaginer la glace raclant le sommet et les flancs du mont Rigaud – plusieurs roches en portent encore les marques. D’impressionnantes rivières se formèrent le long de ses pentes qu’elles dévalèrent en cascadant avec une énorme pression, puis elles se canalisèrent parfaitement à travers les terres. Ce courant sauvage et puissant percuta et façonna les roches et forma un littoral depuis longtemps disparu, toutefois les pierres rondes du « champ de patates » (près du sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes) attestent ce passé. C’est un fascinant témoignage visible.
Les glaciers finirent par disparaître complètement et l’actuelle rivière des Outaouais se forma au nord et à l’est du bassin versant du ruisseau 53, tandis qu’au sud se forma le système des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, et ces deux systèmes fluviaux drainèrent l’eau de l’intérieur du continent.
-

-
Si l’on regarde le paysage à partir du mont Rigaud, il est possible de comprendre non seulement la nature éphémère de nos actuels cours d’eau, mais aussi le fait que les arbres, les plantes et les milieux humides actuels ne sont rien d’autre que le produit de phénomènes géologiques du passé récent. Les fleurs sauvages, les insectes et les champignons que nous nous réjouissons de voir aujourd’hui sont assurément ici depuis plus longtemps que nous, mais ils n’en sont pas moins de relativement nouveaux venus. Ce qui ne nous empêche évidemment pas de vouloir qu’ils y soient encore longtemps après nous.
Chris Buddle, assisté du professeur George McCourt (géologue)
Photo prise d'un drone - Thomas Leszkiewicz